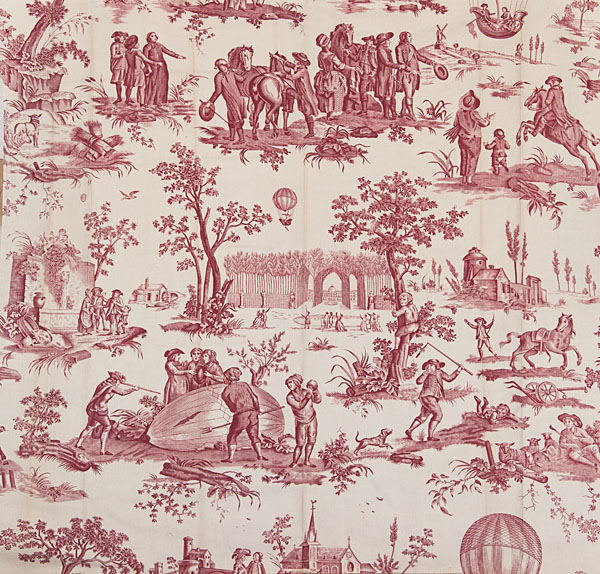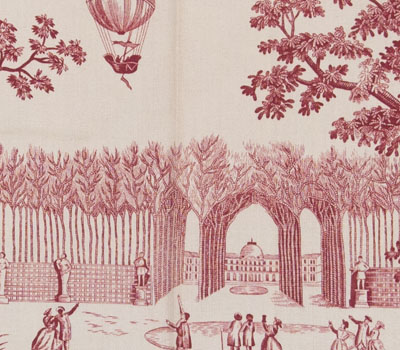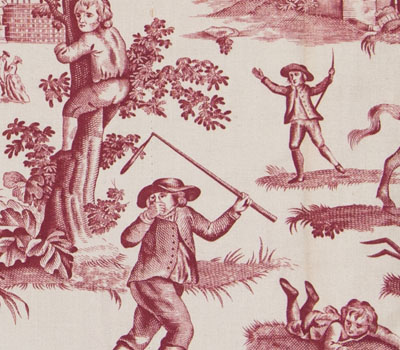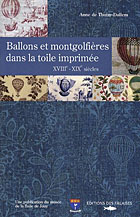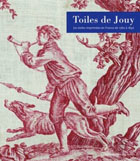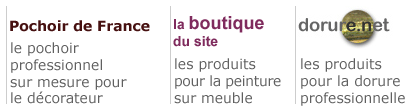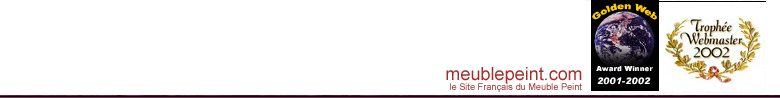La toile de Jouy : un fabuleux répertoire de motifs l'exemple du
Ballon de Gonesse
|
par
Catherine AUGUSTE
ancienne élève des Beaux-Arts de Paris
désigne et décore des cabinets de curiosités |
La toile de Jouy évoque généralement une toile monochrome à
fond blanc d’où se détachent le plus souvent des scènes champêtres
mais aussi mythologiques, exotiques, de genres…En réalité les
productions étaient beaucoup plus variées, incluant essentiellement
des cotonnades à motifs floraux ou géométriques. Son origine a pour
base la Manufacture Oberkampf installée à Jouy-en-Josas dans la
vallée de la Bièvre à quelques encablures de Paris à partir de 1760.

Manufacture
fondée par Oberkampf : le séchage des toiles - Huet (1807)
Aujourd’hui, vous pouvez visiter le musée de la Toile de Jouy qui
relate cette aventure « industrielle » au château de l’Eglantine à
Jouy-en-Josas. Mais avant de vous y rendre, faisons un petit retour
dans le passé pour expliquer le rayonnement de cette toile imprimée
et connaître son principal protagoniste, Christophe-Philippe
Oberkampf.
|
1/ Les premières toiles imprimées : les Indiennes
|
Détail, planche
38 de l'Animal dans la Décoration. |

Bordures aux motifs fleuris de la Manufacture Oberkampf (Musée de la
toile de Jouy, Jouy-en-Josas)Dès le XVIIe siècle
arrivent en Europe des toiles teintes ou parfois peintes,
importées des Indes et dont les motifs sont obtenus par
impression et non par tissage des fils de couleur.
L’engouement est énorme du fait des couleurs vives, de la
légèreté et de la fraîcheur de ces cotonnades. En réaction,
les corporations nationales, notamment les soyeux lyonnais,
se sentant menacés s’appuient sur le Conseil d’Etat pour en
interdire l’importation en 1686 comme la production et
l’utilisation en France. Malgré cette prohibition royale,
les toiles imprimées continuent de circuler car des villes
franches, comme Marseille, n’y sont pas soumises. Devenue
impossible à gérer, la prohibition est finalement abolie en
1759. Dès la levée de l’interdit, l’impression sur étoffes
se développe partout en France et à Paris dans les quartiers
de l’Arsenal et des Gobelins là où Oberkampf est embauché
dès son arrivée en France. |
2/ La Manufacture de Jouy et Monsieur Oberkampf (1738-1815)
|
|
Christophe-Philippe Oberkampf, né en
1738 en Allemagne de grand-père et père teinturiers, part
pour Paris en 1758 comme graveur et coloriste chez Cottin à
l’Arsenal. Rapidement Antoine de Tavannes lui offre un poste
de directeur dans une imprimerie d’indiennes qu’il monte à
Paris.
Face à l’encombrement du quartier de l’Arsenal, le transfert
de l’établissement est décidé en début 1760 à Jouy-en-Josas
sur un site qui présente de nombreux avantages : une
rivière, la Bièvre, pour les lavages successifs des toiles ;
de grands prés pour étendre les toiles et les faire blanchir
; une proximité géographique aux marchés de la cour de
Versailles et de la capitale.
Le 1er mai 1760 Oberkampf imprime sa première toile à
Jouy-en-Josas.
En 1783, son établissement reçoit le titre de « manufacture
royale ».
Ses compétences le font reconnaître par l’ensemble de la
profession comme sa bienveillance auprès de ses employés.
En 1805, la manufacture emploie plus de 1300 ouvriers, un
nombre qui traduit le succès des toiles de Jouy. La
manufacture ferme définitivement en 1843 après 83 ans
d’activité. |
3/ Toiles de Jouy : techniques et motifs
|

Planche de bois gravée avec plombines, outil utilisé pour
l'impression des couleurs sur coton au XIXEME

Motid des
Bonnes Herbes de la manufacture d'Oberkampfi |
Impression
De la préparation de la toile écrue aux motifs imprimés, le
processus de fabrication est long.
Le coton arrive tissé à Jouy. Les principaux fournisseurs
d’Oberkampf sont de Suisse, de France (Rouen, Beaujolais), et aussi
d’Inde par l’intermédiaire des compagnies des Indes. L’achat de
toile de qualité nécessite des sommes importantes.
Puis la toile est mordancée afin que les couleurs puissent se fixer
sur le coton. Un bon mordançage conduit à une netteté parfaite du
motif, de même que la nature du mordant influe sur la couleur
finale.
Une fois le mordant appliqué, la toile est teinte en cuve ; le
colorant se fixe alors là où le mordant a été déposé. Pour appliquer
le mordant trois techniques sont utilisées :
- la planche de bois gravée en relief, à chaque couleur d’un motif
correspond une planche de bois ; à titre indicatif, un bon ouvrier
peut imprimer une trentaine de mètres en quatre couleurs, par jour
- la plaque de cuivre gravée en creux apparaît en 1770 à Jouy ; pour
faire des demi-tons le graveur réalise un jeu de hachures sur la
plaque ; les toiles imprimées à plaque de cuivre sont monochromes et
la finesse de leur dessin s’approche de la gravure sur papier
- la machine à imprimer au rouleau de cuivre est introduite en 1797
; elle permet d’imprimer jusqu’à 5000 m de tissu en un jour ; le
rouleau est gravé en creux ; cette technique permet de travailler
davantage les fonds entre les motifs.
Enfin, pour terminer, la toile est blanchie, séchée, lissée et
parfois passée à la bille d’agathe pour lui donner un rendu
brillant. Les pièces de tissu mesurent environ 21 m de long pour une
largeur de 0,80 à 1 m de large.
Les motifs
Ils sont de deux sortes à la manufacture Oberkampf :
• Motifs floraux ou géométriques : le nombre de dessins créés
s’élève à plus de 30000 motifs floraux ou géométriques pour
l’impression à la planche de bois
• Scènes à personnages : 650 motifs en camaïeu pour l’impression à
la plaque ou au rouleau de cuivre. Ainsi à Jouy, les toiles
imprimées étaient essentiellement des toiles à motifs floraux ou
géométriques destinées à l’habillement et le plus souvent utilisés
jusqu’à l’usure. Alors que les toiles à personnages et scénettes que
nous appelons «Toile de Jouy» aujourd’hui, étaient destinées à
l’ameublement.
|
4/ Un exemple : le ballon de Gonesse
|

Expérience phisique de la machine aréostatique De Mrs. de
Montgolfier Danonai en Vivarais, Répétée à Paris le 27 Aoust
1783 au Champ de Mars, avec un Balon de Taffetas enduit de
Gomme Elastique de 36 pieds 6 pouces de circonférence rempli
d'airs inflammable, par Mr. Robert, sous la direction de Mr.
de Faujas de St. Fond, Et de Mr. Charles Profesr. de
Phisique. Ce Balon après avoir parcouru 4 lieues dans les
Airs en 3 quarts d'heure est tombé à Gonesse
Source Gallica, BNF

Allarme générale des habitants de Gonesse, occasionée par la
chûte du Ballon Aréostatique de Mr. De Montgolfier
Source Gallica, BNF
|

Le ballon de Gonnesse : toile à la plaque de cuivre,
imprimée pour la première fois en 1784 à la Manufacture
Oberkampf :
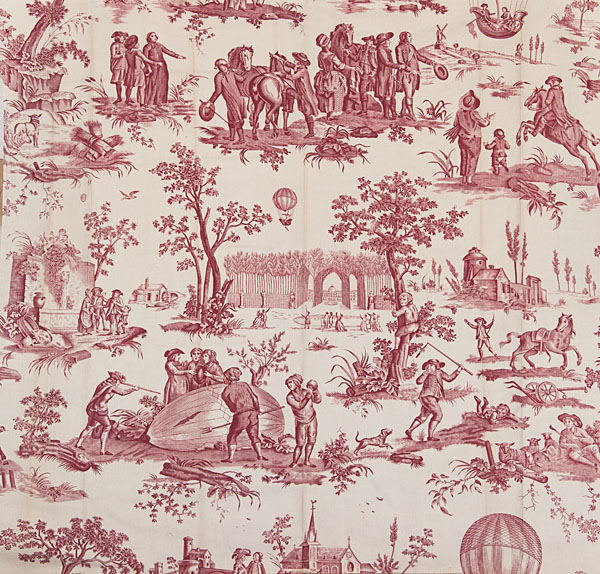
(raccord sauté de 98 cm, largeur toile de 95 cm,
actuellement Manufacture Charles Burger)
L’auteur du motif n’a pu être identifié ; les dessins
préparatoires sont actuellement disponibles au Musée des
Arts décoratifs de Paris.
Cette toile de Jouy illustre l’engouement pour les
ballons et la conquête de l’air.
Plusieurs événements ont marqué l’année 1783 :
Premier
événement : le 19 juin 1783 s’envole de Versailles un ballon
gonflé à l’air chaud avec une nacelle suspendue habitée par
un coq, un mouton et un canard
Deuxième événement : le ballon de Gonesse, sans
voyageurs, est lancé le 27 août 1783. C'est un ballon gonflé
à l’hydrogène, construit par les frères Robert et le savant
Charles. Il part du Champ de Mars à 17 heures. 45
minutes plus tard, il s'écrase sur Gonesse. A cette époque,
s'élever dans les airs est un prodige et les Gonessiens
n’ayant aucune connaissance des expériences précédentes vont
céder à la panique. Cette même année 1783, le gouvernement
distribue un avertissement au peuple garantissant le
caractère inoffensif des ballons.
Troisième événement : le 1er décembre 1783, un ballon
part des Tuileries et descend le même jour dans la prairie
de Nesles, où il est accueilli par les notables. En
réalité la toile de Jouy évoque ces trois événements à
lafois : le ballon de Gonesse n’était pas habité
contrairement à ce qui est représenté sur la toile.
Sur la toile de Jouy on distingue quelques scènes :
- Au centre, le Champs de Mars derrière une haie d’arbres
avec quelques spectateurs autour d’un bassin regardant le
ballon dans le ciel :
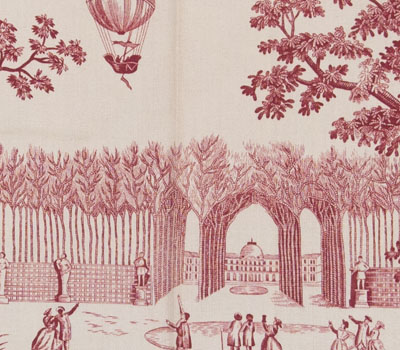
- Juste au-dessus un groupe de notables ou de mondains salue
les deux passagers de l’aéronef orné d’un médaillon aux
fleurs de lys :

à gauche de ce groupe sur une autre scénette on distingue
le curé avec deux autres personnes également admiratifs.
- Les scénettes du bas du panneau illustrent au contraire de
l’épouvante : une lavandière abandonne son linge,

un paysan
s’accroche à un arbre, d’autres partent en fuyant,
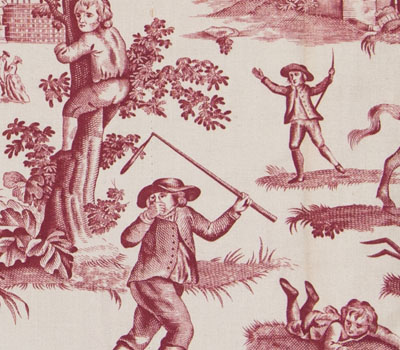
- Puis la scène cruciale avec le ballon écrasé et
l’attroupement affolé des habitants de Gonesse tentant de
tirer ou de massacrer le ballon écrasé à coups de pic :

- Plus bas encore, un couple de notables en promenade aux
abords de l’église Saint-Pierre de Gonesse.
Les scénettes sont agrémentées de représentations dans le
goût des scènes champêtres : moulin à eau, à vent, quelques
arbres à une échelle inférieure, montrant ainsi la distance
parcourue par le ballon depuis el Champs de Mars. On
pourrait voir dans ces rapports d’échelle la métaphore du
décalage perceptible entre les paysans de la campagne
apeurés et les urbains ébahis.
Autres toiles de Jouy rapportant l’engouement pour les
ballons : Roses et montgolfière (1784) par la manufacture de
Jouy, Montants de fleurs ondulants et ballons (1785) par une
manufacture nantaise, Première traversée de la Manche (1785
?) par la manufacture de Jouy
|
4/ Bibliographie / liens internet
|
|
|
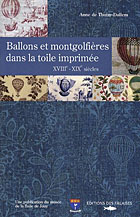
Ballons et Mongolfieres Dans la Toile Imprimee
De Anne de Thoisy-Dallem, Editions des Falaises, Une
publication du Musée de la Toile de Jouy, 48 pages, 2009
L’exposition "Voyages en ballon, l’aérostat dans les arts
décoratifs aux XVIIIe et XIXe siècles" s’articule d’abord
autour d’un emprunt très important du musée de la toile de
Jouy : il s’agit de la collection Muller-Quênot
(porcelaines, mobilier, peintures, gravures, dessins…)
déposée à Rosheim en Alsace en attendant qu’un beau musée ne
lui soit consacrée. Cette superbe collection a pu être
admirée dans sa quasi intégralité, soit 270 pièces d’art
décoratif retraçant l’histoire de cette première conquête de
l’air par l’homme. Elle a été enrichie d’une collection de
toiles de Jouy originaires de la célèbre manufacture
d’Oberkampf ou d’autres manufactures de toiles imprimées
(Alsace, Nantes, Normandie) décorées de charlières,
montgolfières ou autres machines comme celle de Blanchard.
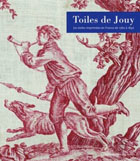
Toiles de Jouy : Les toiles imprimées en France de 1760 à 1830
de Sarah Grant et Christine Smith Editions
La Bibliothèque des Arts (21 octobre 2010), 144 pages
Deux liens sur le net :
La consommation des indiennes à Marseille (fin XVIIIe-début
XIXe siècle)
Par Aziza Gril-Mariotte
http://rives.revues.org/1403?lang=en#abstract
Le site du Musée de la Toile de Jouy
http://www.museedelatoiledejouy.fr/ |
|