Le secret des Van Eyck
|

par
Jean-Charles
FUMOUX
ancien élève de Robert Mermet
restaurateur de tableau, professeur de peinture
74 Bvd de Cessole
06100 Nice
04 92 09 88 65
jc.fx@orange.fr
peindre-vrai.fr
|

Vierge au chancelier Rolin (vers 1435) - Musée du Louvre, Paris
La peinture des frères VAN EYCK, plus particulièrement celle de Jan,
a fait l’admiration de tous ceux qui l’ont approchée. Ce n’est pas
tant les sujets qui ont provoqué cette admiration mais bien plus la
qualité de la peinture elle-même. |
L’apport de Jan Van Eyck
|
|
On a longtemps attribué à Jan Van Eyck
la découverte de la peinture à l'huile. On affirmait même que
c'était en 1410 que cet artiste avait imaginé de dissoudre les
couleurs dans de l'huile de noix ou de lin. On sait maintenant que
les Romains se servaient de la peinture à l'huile pour de grossiers
ouvrages de décoration, mais rien n'établit nettement qu'ils l'aient
employée à exécuter de véritables tableaux. On a retrouvé plusieurs
peintures à l'huile antérieures à Van Eyck, et l'on sait que, dès
1355, Jean Coste peignait à l'huile en France.
Bien avant la naissance de Van Eyck,
la peinture à l’huile est décrite dans l’ouvrage Diversarum
artium schedula du moine Théophile. Cet auteur fait remarquer
que l'huile est lente à sécher, et c’est probablement cet
inconvénient qui a empêché les artistes du Moyen âge d'en faire
usage.
En 1550, Vasari (1) cite « Jean de
Bruges » comme l’inventeur de la peinture à l’huile. Cette
affirmation, souvent répétée, est devenue depuis une évidence. En
fait, il s’agit d’une légende.
Van Eyck n’est aucunement l’inventeur
de la peinture à l’huile, il ne fit que perfectionner une technique
déjà connue. Il a seulement eût l’idée de faire cuire les huiles
ordinaires et d'y mêler diverses substances, dont une ou plusieurs
résines afin qu’elles sèchent plus rapidement. Ses procédés furent
surpris par Antonello de Messine, portés en Italie, et adoptés par
les artistes.
Pour cette raison, l’apport des Van
Eyck dans le domaine de la peinture à l’huile est capital.
La gloire de Van Eyck gagna vite toute
l’Europe. L’étonnant et méticuleux naturalisme de ses tableaux
passionna les Italiens, les peintres comme les collectionneurs :
Frédéric II d’Urbino, Alphonse d’Aragon, les Médicis possédaient de
ses œuvres. Mais c’est en Flandre que la postérité de l’œuvre est
surtout intéressante. Il faut noter qu’à Bruges les peintres
développèrent largement son style et sa technique.
En ayant résolu le grand problème du
temps de séchage de la peinture à l’huile, on doit reconnaître que
Jan Van Eyck est à l’origine de l’essor prodigieux de cette
discipline artistique, devenue depuis un art majeur.
Tout a changé à partir du moment où
l’on a pu combiner l’huile cuite avec une essence volatile.
Une majorité de spécialistes sérieux
admettent aussi que l’une des principales démarches qui animait les
peintres de l’époque était surtout de tenter d’élaborer une peinture
qui permette d’imiter l’émail sur une surface importante, d’où la
recherche persistante d’une peinture la plus brillante possible.
Les légendes qui entourent les Van
Eyck, leurs techniques et surtout la composition de leur peinture
sont nombreuses. Il existe pratiquement autant de thèses que
d’auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Le mystère est d’autant plus
profond et persistant que la grande majorité de ceux qui
s’intéressèrent à ce problème étaient parfaitement étrangers au
monde de la peinture et de ses techniques.
L’une de ces légendes, celle qui se
rapproche peut-être le plus de la vérité, veut que Van Eyck passa
des mois de recherches, essayant différentes huiles et résines pour
élaborer un vernis à peindre ou médium. Mélangé à la peinture, ce
médium permettait à celle-ci de sécher à l’ombre ce qui était une
nouveauté à l’époque. Il constata qu’il pouvait rectifier ou
reprendre l’œuvre pendant que les couleurs séchaient, sans risque de
les diluer, ce qui était aussi nouveau à l’époque. De plus, en
séchant les couleurs conservaient un incroyable brillant.
Certains auteurs limitent le rôle de
Jan Van Eyck à la seule introduction d’un diluant volatil jusque là
inconnu, dans un mélange de matériaux connus de ses prédécesseurs.
Je partage cette opinion. Tout a changé à partir du moment où l’on a
pu combiner l’huile cuite avec une essence volatile. Ce procédé
apportait à la peinture une dimension nouvelle, grâce aux effets
désormais possibles de superpositions translucides, les glacis qui
enrichissent tellement la matière. Ainsi, en superposant des
couleurs différentes, obtenait-on par mélange optique une nouvelle
couleur. Le rouge était peu couvrant à cette époque et plusieurs
couches superposées vont enfin donner un rouge profond. En utilisant
cette merveilleuse technique du glacis, l’Europe entière allait,
pendant trois siècles, produire des œuvres prodigieuses. Qui
d’entre-nous n’a-t-il jamais entendu parler des sfumato de Léonard
De Vinci ?
D’autres pensent, au contraire qu’il
était détenteur d’un secret qu’il n’a jamais communiqué à personne
et qui consistait probablement dans la composition d’un agglutinant
à base d’ambre ce qui amena à penser qu’il avait réussi la
dissolution de l’ambre à froid.
Notons qu’actuellement les
laboratoires de recherche ne savent pas dissoudre l’ambre à froid et
que les résultats des analyses sur un vernis vieilli ne permettent
pas d’en définir avec précision la nature primitive. Cela vient
renforcer le mystère et, par là même, les légendes qui entourent cet
homme, son œuvre, sa technique.
|
Mes constatations
|
|
Je n’ai aucunement la prétention de
résoudre ici un problème qui est considéré depuis des siècles comme
insoluble. Cependant, les éléments historiques que j’ai pu
recueillir et confronter à la pratique m’ont permis d’obtenir une
peinture dont l’aspect et les qualités s’apparentent beaucoup à
celle de Van Eyck et des primitifs flamands.
Ce fait, je le pense, ne manquera pas
d’intéresser les peintres puristes toujours à la recherche de
meilleurs matériaux.
Pour essayer de comprendre la démarche
qui a conduit ce peintre à améliorer la peinture de son époque, au
point d’obtenir une peinture d’une qualité si exceptionnelle qu’elle
changea l’art de peindre à tout jamais, il convient tout d’abord de
se replacer le plus justement possible dans le contexte de l’époque.
En peinture décorative, il était alors
habituel d’utiliser l’huile de noix, parfois en coupage avec l’huile
de lin. Mais, à cette période, ces deux huiles étaient produites
d’une autre façon que celle en usage aujourd’hui. En effet, avant
d’être pressés les cerneaux étaient torréfiés, ce qui donnait des
huiles bien différentes de celles que nous connaissons. Elles
étaient plus visqueuses et d’une siccativité beaucoup plus grande.
Le principal défaut qu’on prête à
l’huile de noix, de nos jours, est d’avoir une siccativité médiocre.
Cela est totalement faux ! Elle obéit à un processus de
siccativation différent de celui de l’huile de lin. Ceci a été
clairement démontré dans une étude menée par un laboratoire
spécialisé d’une université française. Les conclusions démontrent
que l’huile de noix démarre plus lentement son processus de
siccativité que l’huile de lin mais qu’ensuite celui-ci est plus
complet, générant par là même un film de linoxyne beaucoup plus
résistant et plus brillant que celui de l’huile de lin.
Les Maîtres anciens, eux, utilisaient
une huile de noix cuite. La cuisson sans brutalité (120°) qu’ils
pratiquaient, faisait qu’ils obtenaient alors un produit de forte
viscosité et de grande siccativité qui conférait à leur peinture un
moelleux agréable. Dès lors que la peinture fut mise en tubes, la
cuisson des huiles de broyage fut abandonnée. En effet, pour éviter
un séchage dans le tube, les fabricants de peintures optèrent alors
pour les huiles crues les moins siccatives. C’était abandonner une
pâte qui convenait parfaitement à un style exigeant une grande
précision du trait et un fini minutieux. Les huiles cuites, plus
particulièrement l’huile de noix, en effet, donnent des pâtes
onctueuses, faciles à travailler dont le séchage particulier
facilite grandement la pose des glacis dans le frais, contrairement
même à l’huile de lin cuite.
Je découvris également que dans les
années 1410 deux produits inconnus ont fait leur apparition à Bruges
où ils séduisirent rapidement les peintres.
Pour le premier, il s’agit du Bijon,
le baume de mélèze dont on tirait l’essence de térébenthine de
Venise.
Pour le second, il s’agit de l’essence
de lavande.
Le grand spécialiste de la peinture à
l’huile que fut Xavier de Langlais (2) a insisté sur les qualités
extraordinaires que le baume de térébenthine de Venise confère à la
pâte à laquelle il est ajouté. Il lui donne éclat et brillance d’une
grande douceur et transparence.
En ce qui concerne l’essence de
lavande, Xavier de Langlais a justement noté que les vieux maîtres
la tenaient en haute estime.
Cependant, il est dommage qu’il n’ait pas poussé plus avant ses
expériences sur ce produit, actuellement très déprécié en peinture
car on lui reconnaît trois défauts majeurs. Celui de sécher
lentement, de donner un trop grand moelleux à la pâte et de libérer
une forte odeur. Cependant, ce produit possède des vertus
remarquables pour la fabrication de la peinture artistique. Bientôt,
nous allons voir que les deux premiers défauts qu’elle semble
posséder constituent, tout au contraire, des avantages conséquents
que nous allons mettre à profit.
Mais, contrairement aux autres, cette
essence possède une propriété remarquable.
Elle dissout à froid toutes les
résines !
Absolument toutes les résines :
Dammar, Copal, Mastic de Chios, Colophane, etc. et ceci dans des
proportions étonnantes qui vont jusqu’à part de poids égal pour
certaines d’entre-elles. Mais plus étonnant encore elle dissout
également... l’ambre !
Précisons immédiatement que l’essence
de lavande dissout l’ambre à froid, dans une faible proportion,
environ 10 grammes de résine pour 100 grammes d’essence, mais
toutefois il faut attendre plusieurs mois. A chaud, par contre, la
dissolution est conséquente. En procédant en plusieurs chauffes, la
dissolution atteint environ 30% du poids !
Comme on peut le constater Jan Van
Eyck possédait donc tous les ingrédients susceptibles de le conduire
à inventer une peinture aux propriétés très différentes de tout ce
qui existait auparavant.
|
Mes hypothèses
|
|
Mes essais personnels me conduisent à
nier les propriétés exceptionnelles que certains prêtent à l’ambre.
Les produits que j’ai obtenus en l’utilisant comme seule résine se
sont révélés décevants.
Par contre les liants et médiums que
j’ai fabriqués avec une seule résine tendre, la Dammar en
particulier, ou un mélange de celle-ci en combinaison avec du baume
de mélèze, du stand-oil, de l’huile de noix cuite et de l’essence de
lavande m’ont permis d’obtenir une peinture dont les
caractéristiques s’apparente à celle des maîtres anciens.
C’est-à-dire une brillance et un éclat exceptionnels. La pâte sèche
vite, mais de façon uniforme et sans aucun retrait. D’autre part la
couleur ambrée du liant et du vernis à peindre ne dénature en aucune
façon la couleur propre du pigment, mais vient tout au contraire la
renforcer.
Personnellement, je ne pense pas que
Jan Van Eyck ait utilisé l’ambre d’une quelconque façon. Mes essais
avec l’ambre ont été si décevants que je suis convaincu de cela. Les
mythes ont la vie dure. Par contre je partage pleinement les avis de
Xavier de Langlais en ce qui concerne les propriétés exceptionnelles
du Bijon.et du stand-oil. Utilisés de pair, ils confèrent brillance,
éclat et dureté aux couleurs auxquelles ils sont ajoutés. Le Bijon
est d’ailleurs une résine naturelle chimiquement proche de l’ambre,
résine fossile produite par la compression d’un baume produit par un
arbre de la même famille que le mélèze !
Les liants et médiums à forte
concentration résineuse qu’on peut fabriquer en utilisant le Bijon
possèdent une douce couleur ambrée. Je pense que cette couleur, et
elle seule, est à l’origine du mythe qui prête à Van Eyck la faculté
d’avoir réussi la dissolution de l’ambre.
D’autre part, replongeons-nous dans le
contexte du quinzième siècle où cette peinture révolutionnaire fut
mise au point. Seuls les initiés qui fréquentaient les ateliers ou
les guildes ont eu connaissance de l’existence du Bijon et de
l’essence de lavande qui venaient d’arriver dans les Flandres. Les
autres, particulièrement de riches clients, ont pu se méprendre lors
d’une de leur visite à l’atelier. L’ambre était connue et en voyant
un flacon de térébenthine de Venise ou de médium résineux dont la
couleur est proche, ils ont pu faire l’amalgame entre les deux
matières.
|
Mes recettes
|
|
La qualité des résines employées
influe directement sur la qualité du liant ou du médium que nous
allons obtenir.
J’ai utilisé de la gomme
Dammar Batavia, du Copal blanc de Sierra Léone, une essence de
lavandin, du stand-oil encore appelé huile hollandaise ou
standolie de 30 poises provenant du Canada. Quant au
Bijon je
l’ai récolté moi-même.
Dans toutes les recettes qui suivent
les résines se présentent sous forme de poudre impalpable. Cette
poudre peut-être obtenue en martelant les résines en blocs dans un
mortier ou dans un linge très fin.
DANGER : Ne jamais faire chauffer
l’essence ou les résines à feu nu !
Dans un premier temps, je fabrique un
« sirop » de résine à concentration maximum dans de l’essence de
lavande chauffée à 60°. Pour obtenir cette température, il suffit de
plonger le flacon contenant l’essence dans un récipient rempli d’eau
bouillante.
 Partant de ce sirop, nous allons
fabriquer maintenant un liant de la consistance d’un sirop épais
composé d’huile
de noix cuite, de 30% de
térébenthine de Venise et de 10% de
stand-oil. Ce liant THIXOTROPIQUE (3) sera mélangé aux pigments
pour donner une peinture d’exceptionnelle qualité. Mais, plus
étonnant il sera aussi employé tel quel comme vernis à peindre !
Sa qualité Thixotropique alliée à
l’onctuosité donnée par l’essence de lavande en font un médium
idéal. Mélangé à la pâte, même en très forte proportion, il ne
produit aucun tirant mais donne une pâte ou des glacis d’une
brillance et d’un éclat exceptionnels. D’autre part, Il facilite le
travail des glacis dans le frais.
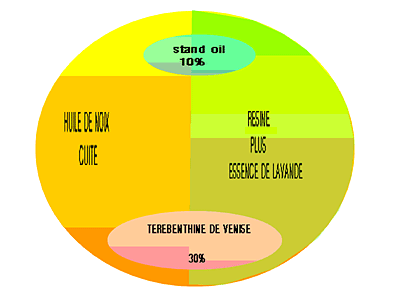 Quand on fabrique un liant ou un
vernis à peindre avec une essence différente de l’essence de lavande
: pétrole, essence de térébenthine, on est limité dans la
dissolution de la résine. En effet, le tirant important qu’on
obtient alors interdit tout travail. Le séchage lent et le moelleux
qu’apporte l’essence de lavande, reconnus longtemps comme défauts,
jouent ici un rôle primordial en permettant une dissolution maximum
des résines.
Je pense que c’est là que réside le
secret de Jan Van Eyck ou l’élément principal de son secret. Quelque
part cela me réjouit car la Provence et ses lavandes que j’aime tant
n’est peut-être pas complètement étrangère au secret des maîtres
flamands et à l’essor de la peinture à l’huile.
|
Bibliographie
|
|
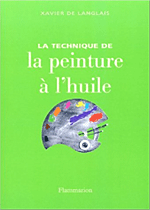
La technique de la peinture à l’huile
Xavier de Langlais
Editions Flammarion, 493 pages, 2000
Le grand livre de la peinture à l’huile
José-Maria Parramon
Editions BORDAS, 1997
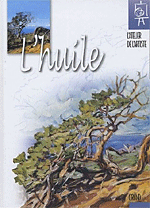
L’huile
Jean Prigent
Editions Gründ, 94 pages, 2005
De la peinture à l'huile :
Ou, des procédés matériels employés dans ce genre de peinture :
depuis Hubert et Jean Van-Eyck jusqu'à nos jours
J.-F.-L. Mérimée
Edition EREC, 323 pages, 1981

Technique de la peinture
Jean Rudel
PUF, 128 pages, 1999
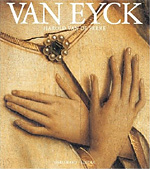
Van Eyck
Harold Van de Perre
Editions Gallimard, 1997

L’ABCdaire de Van Eyck
Damien Sausset
Editions Flammarion, 120 pages, 2002 |
|

