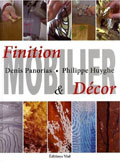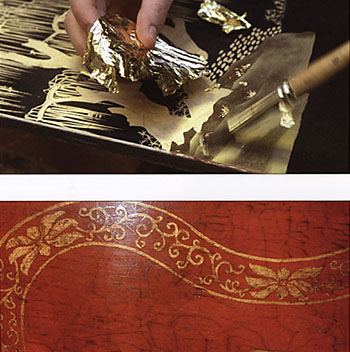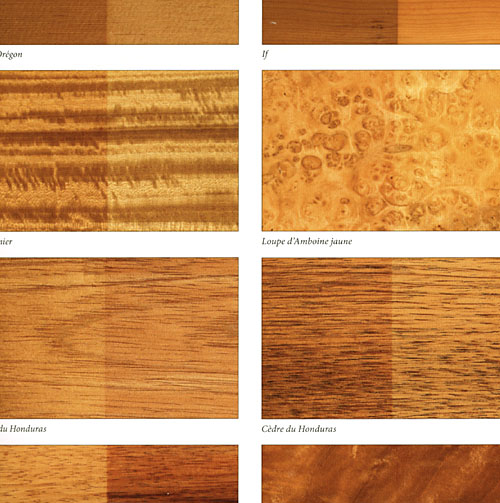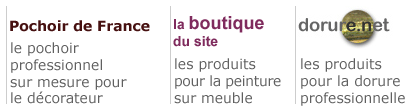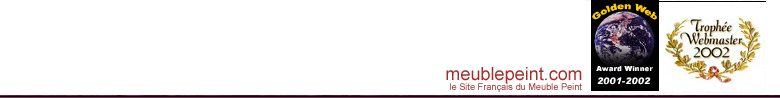finition et décor du mobilier
Un "catalogue des possibles"
|
|
Les auteurs, Denis Panorias et Philippe Huyghe,
tous deux professeurs à l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués
BOULLE, respectivement en ébénisterie et en finition et traitement
des surfaces, nous proposent un ouvrage très visuel sur les
transformations de la « peau » du meuble, que celle-ci soit de bois
ou de métal, que les produits de finition soient anciens ou de
synthèse.
On passe ainsi des lasures aux effets de laques sans
oublier les possibilités d’inclusion, les reliefs granuleux ou même
les empreintes. Les artisans en mal de créativité pourront puiser
sur ces pièces réalisées pour l’essentiel par des élèves de l’école
BOULLE et quelques ateliers des idées de surface. Chacune de ces
pièces sont décrites si brièvement que rien ne nous permettrait de
reproduire ces effets gardés à jamais dans le secret des ateliers
mais elles offrent des pistes de recherche. On pourrait ainsi rester
sur sa faim, sur cette impossibilité à « re-faire » ce qui nous est
présenté par manque d’informations.

© panorias et huyghe
Les différents panneaux dérivés
de bois sont présentés avec leurs caractéristiques et leurs
usages.
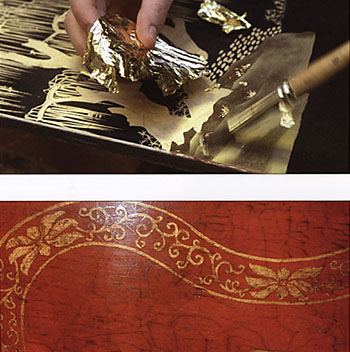
© atelier
midavaine
Effet craquelé sur
support souple marouflé ; ce procédé permet aux laqueurs
professionnels d’obtenir des fonds craquelés, le décor est
réalisé sur une toile qui est ensuite marouflée sur
l’ouvrage. Cet exemple est une création de l’Atelier
MIDAVAINE.
Cependant ce « catalogue des possibles », comme
le définit Bruno Schachtel, préfacier de l’avant-propos, décline
dans sa première partie une série de conseils riches en
enseignements. C’est la partie qui nous intéresse le plus car elle a
le mérite de nous rappeler qu’un meuble doit se concevoir dès les
premiers traits en tenant compte de la finition.
Cette première partie, intitulée dans le
sommaire, Les Finitions, aussi importante en nombre de pages que le
catalogue des possibles de la deuxième partie, est très instructive
et répond à de nombreuses questions qui nous sont posées
régulièrement sur le site du meuble peint.
|
Un exemple de chapitre : le ponçage
|
|
Pour faire comprendre combien ce livre est
pédagogique, nous avons choisi de présenter le chapitre relatif au
ponçage.
Les auteurs nous indiquent
en premier lieu l’étymologie : poncer signifie polir à la pierre
ponce. Depuis la pierre ponce nous avons vu l’apparition de
nombreuses variétés de matières abrasives : le verre, le silex et
aujourd’hui l’oxyde d’alumine pour le bois ou le carbure de silicium
pour le vernis. Ces matières abrasives sont disposées sur papier,
cartons ou toiles et les granulométries proposées sont variées,
allant de 80 à plus de 2000.
Quelques règles sont
impératives à suivre au risque de compliquer l’opération du
ponçage :
- Ne pas utiliser un abrasif à l’eau sans
l’humidifier
- Les abrasifs à l’eau sont utiles pour le
ponçage fin des laques et des vernis
- Ne pas utiliser un abrasif sec par voie
humide
- Poncer dans le sens du fil du bois
- A partir du grain 600, utiliser des abrasifs
à l’eau pour limiter les rayures
- Ne pas laisser s’encrasser l’abrasif, les
rayures apparaissent…
Mais à quoi sert le ponçage ? Et comment bien poncer, gage d’une
belle finition ?
Tout d’abord le ponçage sert à éliminer les
imperfections laissées par le racloir. Il favorise également
l’accrochage des produits de finition. Pour ces deux raisons il
conditionne la qualité finale de l’ouvrage.
Pour réaliser un ponçage efficace et sans
fatigue, il faut utiliser des abrasifs de plus en plus fins qui
seront maintenus sur une cale à poncer. Cette cale, disponible dans
le commerce, permettra d’obtenir une belle planéité de la surface.
Commencerez par un grain 150 pour les essences tendres ou fragiles,
120 pour les bois mi-durs ; et quand les défauts sont éliminés,
passez au grain 180, 200 voire 320 avant le vernissage. Les abrasifs
effaceront alors progressivement les rayures.
Si vous appliquez une teinte, évitez de poncer
les fibres relevées par cette mise en teinte. Vous auriez la
désagréable surprise de voir apparaître des perces dans la couleur.
Dans ce cas poncez seulement après le passage du vernis de fond.
Ne confondez pas ponçage et égrenage ; le
ponçage corrige la planéité de la surface, l’égrenage vise un
travail superficiel pour supprimer les grains ou les poussières
emprisonnés dans la couche de fond ou le vernis. Sachez que sur les
apprêts le grain 320 est le plus utilisé, sur les vernis les plus
brillants, vous serez amenés à prendre du grain 1200 à 2000 avant de
passer une pâte à polir.
Les auteurs poursuivent ainsi sur plusieurs
pages passant du ponçage manuel au ponçage mécanique en donnant de
nombreux conseils sur les bons gestes, les abrasifs adaptés selon
les surfaces bois, vernies ou laquées et sur les erreurs plus
fréquentes…
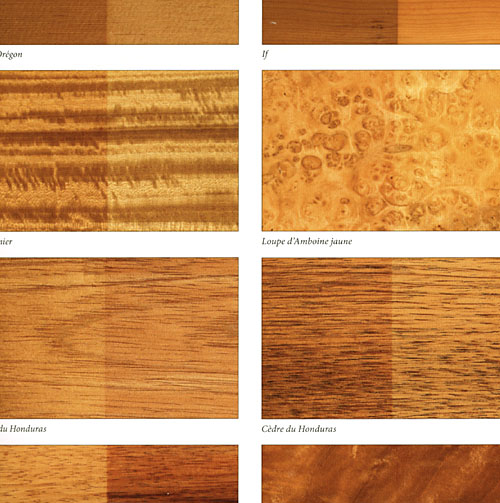
©
marc auroy
Echantillons de bois et modification de
la couleur due à l’exposition à la lumière ;
la partie gauche du bois a subi une exposition à la lumière
naturelle tandis que la droite en a été préservée.
Toute la première partie de l’ouvrage est
particulièrement adaptée à qui veut commencer dans les meilleures
conditions ou à celui qui s’interroge sur certains produits en
usage. Ils abordent après la mise en teinte et les différents
colorants naturels ou artificiels, comment vieillir ou décolorer le
bois avant de développer les différents produits de finition
traditionnels et contemporains. Un livre écrit par deux enseignants,
un livre pour apprendre.
|
Le sommaire détaillé
|
|
1ère partie, Les Finitions
Incidence des supports sur la finition
(les bois, les panneaux dérivés du bois, autres panneaux supports,
les colles)
La préparation des supports
(le raclage, le ponçage)
La mise en teinte des bois
(les teintes, le vieillissement artificiel du bois, la décoloration,
exemples d’applications des teintes)
Les différents types de produits de finition
(les huiles, les cires, les produits à l’alcool, les
nitrocellulosiques, les polyuréthanes, les hydrodiluables,
comparatif entre les différentes familles de produits, les
caractéristiques des produits, les constituants de produits de
finition)
Les finitions transparentes ou vernies
(les finitions à pores ouverts, les finitions traditionnelles à
pores fermés, les finitions contemporaines à pores fermés)
Les finitions laquées
(la couleur, la colorimétrie, les laques contemporaines, la laque
sur PMMA, la laque végétale)
Le traitement des métaux en ameublement
(la protection des métaux, la coloration ou les patines sur métaux,
le traitement de l’aluminium, l’entretien de l’acier inoxydable)
Le matériel de mise en œuvre des produits de finition
(la pulvérisation pneumatique, la pulvérisation basse pression, la
pulvérisation Airmix, la pulvérisation électrostatique, comment
résoudre les anomalies, les cabines)
Hygiène et sécurité
(l’étiquetage des produits, la fiche technique, la fiche de
sécurité)
2ème partie, Les décors
Les décors laissant transparaître le support
(les patines, les lasures, les glacis, les collages, les décors
cérusés)
Les superpositions de laques
(le masquage, les patines sur laque, l’usinage des laques, le
ponçage des laques, la superposition de laques fraîches)
Les glacis
Les laques craquelées
(le craquelé glycérophtalique, le craquelé cellulosique, le craquelé
sur support souple marouflé)
Les granités
(le granité polychrome, le granité polychrome aux caches)
Les empreintes
Les inclusions
(l’inclusions d’éléments minéraux, de papiers, de végétaux, de
textiles, de feuille d’or, de coquille d’œuf)
Les reliefs
Le décor doré, oxydé et minéral
(le décor à la feuille d’or, les décors oxydés, la laque vert de
gris, la laque pierre, la laque marbre blanc, la laque tôle d’acier)
La laque gravée
La sérigraphie
Les mots pour le dire
Fournitures de produits et matériels
Bibliographie
|
Pour acheter le livre directement
Voir les autres livres des Editions Vial
|
|
|